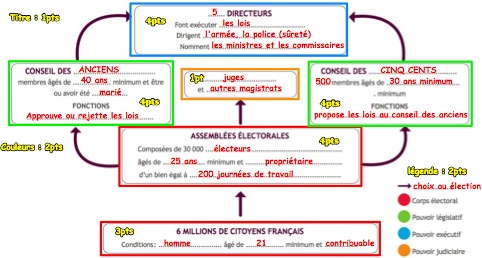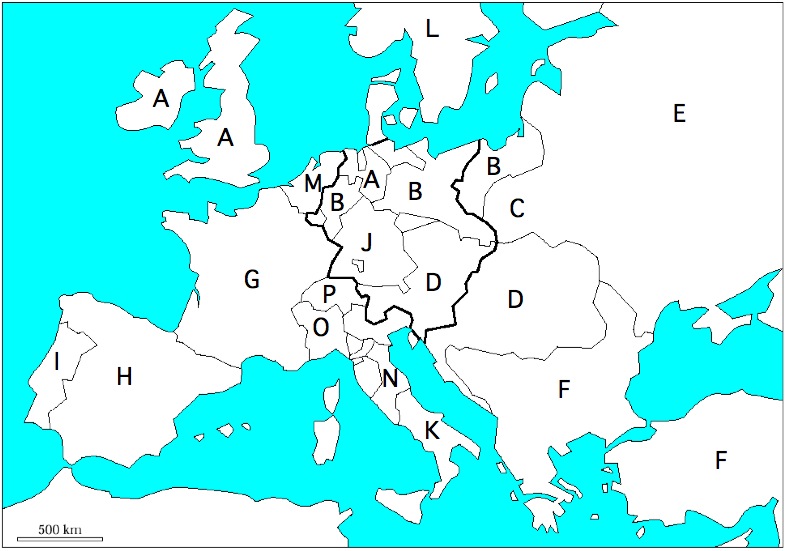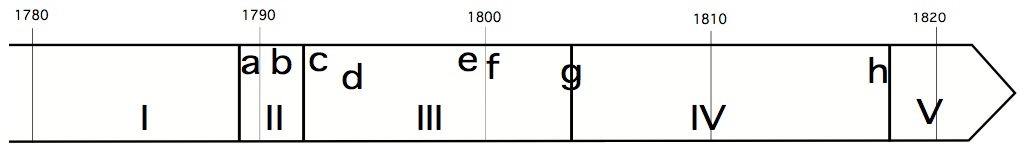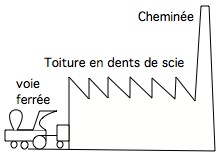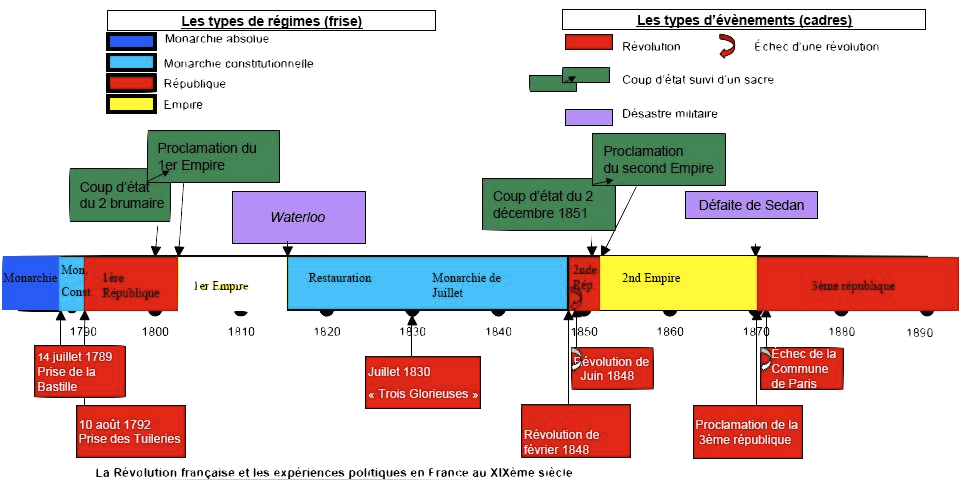Charles X et son ministre le prince de Polignac
veulent renforcer le pouvoir de la monarchie. Le Roi veut
imposer quatre ordonnances tendant à supprimer la liberté de la
presse et à modifier la loi électorale. C'est contraire à la
constitution et les députés refusent, la population se soulève et
en trois jours dits “ Trois Glorieuses ” – les 27, 28 et 29
juillet –, le roi est renversé.
Analyse de l'image
Achevé en décembre, le tableau est exposé au
Salon de mai 1831.
C’est au moment de la victoire, la foule se dirige vers le
spectateur, dans un nuage de poudre, brandissant des armes. Elle
pénètre dans le camp ennemi dirigée par quatre personnages
déterminés dont une femme qui brandit le drapeau tricolore. A
leurs pieds gisent des soldats. La femme, seins nus est une
figure allégorique : la liberté ou la République.
Le tableau est construit en pyramide, au sommet le drapeau
tricolore. On distingue trois plans : Les corps allongés au
premier plan, les personnages en marche en second plan et le
peuple et la ville de Paris en arrière plan.
La liberté
Vision nouvelle de l’allégorie de la Liberté, c'est une fille du
peuple, vivante et fougueuse, qui incarne la révolte et la
victoire. Coiffée du bonnet phrygien, les mèches flottant sur la
nuque, elle évoque la Révolution de 1789, les sans-culottes et
la souveraineté du peuple. Le drapeau, symbole de lutte, faisant
un avec son bras droit, se déploie en ondulant vers l’arrière,
bleu, blanc, rouge. Du sombre au lumineux, comme une flamme.
La pilosité de son aisselle a été jugée vulgaire, la peau devant
être lisse aux yeux des rhétoriciens de la peinture.
Son habit jaune, dont la double ceinture flotte au vent, glisse
au-dessous des seins et n’est pas sans rappeler les drapés
antiques. La nudité relève du réalisme érotique et l’associe aux
victoires ailées. Le profil est grec, le nez droit, la bouche
généreuse, le menton délicat, le regard de braise. Femme
exceptionnelle parmi les hommes, déterminée et noble, la tête
tournée vers eux, elle les entraîne vers la victoire finale. Le
corps profilé est éclairé à droite. Son flanc droit sombre se
détache sur un panache de fumée. Appuyée sur son pied gauche nu
qui dépasse de sa robe, le feu de l’action la transfigure.
L’allégorie est la vraie protagoniste du combat. Le fusil
qu’elle tient à la main gauche, modèle 1816, la rend réelle,
actuelle et moderne.
Les gamins de Paris
Ils se sont engagés spontanément dans le combat. L'un d'entre
eux, à gauche, agrippé aux pavés, les yeux dilatés, porte le
bonnet de police des voltigeurs de la garde.
A droite, devant la Liberté, figure un garçon. Symbole de la
jeunesse révoltée par l’injustice et du sacrifice pour les
nobles causes, il évoque, avec son béret de velours noir
d’étudiant, le personnage de Gavroche que l’on découvrira dans
Les Misérables trente ans plus tard. La giberne, trop grande, en
bandoulière, les pistolets de cavalerie aux mains, il avance de
face, le pied droit en avant, le bras levé, un cri de guerre à
la bouche. Il exhorte au combat les insurgés.
L’homme au béret
Il porte la cocarde blanche des monarchistes et le nœud de ruban
rouge des libéraux. C’est un ouvrier avec une banderolle
porte-sabre et un sabre des compagnies d’élite d’infanterie,
modèle 1816, ou briquet. L’habit – tablier et pantalon à pont –
est celui d’un manufacturier.
Le foulard qui retient son pistolet sur son ventre évoque le
mouchoir de Cholet, signe de ralliement de Charette et des
Vendéens.
L’homme au chapeau haut de forme, à genoux
Est-ce un bourgeois ou un citadin à la mode ? Le pantalon large
et la ceinture de flanelle rouge sont ceux d’un artisan. L’arme,
tromblon à deux canons parallèles, est une arme de chasse.
A-t-il le visage de Delacroix ou d’un de ses amis ?
L’homme au foulard noué sur la tête
Avec sa blouse bleue et sa ceinture de flanelle rouge de paysan,
il est temporairement employé à Paris. Il saigne sur le pavé. Il
se redresse à la vue de la Liberté. Le gilet bleu, l’écharpe
rouge et sa chemise répondent aux couleurs du drapeau. Cet écho
est une prouesse.
Les soldats
Au premier plan, à gauche, le cadavre d'un homme dépouillé de
son pantalon, les bras étendus et la tunique retroussée. C’est,
avec la Liberté, la deuxième figure mythique tirée d’une
académie d’atelier, d’après l’antique, appelée Hector, héros
d’Homère, héroïsé et réel.
A droite, sur le dos, le cadavre d’un suisse, en tenue de
campagne : capote gris-bleu, décoration rouge au collet, guêtres
blanches, chaussures basses, shako au sol.
L’autre, la face contre terre, a l’épaulette blanche d’un
cuirassier.
Au fond, les étudiants, dont le polytechnicien au bicorne
bonapartiste, et un détachement de grenadiers en tenue de
campagne et capote grise.
Le paysage
Les tours de Notre-Dame, symbole de la liberté et du romantisme
comme chez Victor Hugo, situent l’action à Paris. Leur
orientation sur la rive gauche de la Seine est inexacte. Les
maisons entre la cathédrale et la Seine sont imaginaires.
Les barricades, symboles du combat, différencient les niveaux du
premier plan à droite. La cathédrale paraît loin et petite par
rapport aux figures.
La lumière du soleil couchant se mêle à la fumée des canons.
Révélant le mouvement baroque des corps, elle éclate au fond à
droite et sert d’aura à la Liberté, au gamin et au drapeau.
La couleur unifie le tableau. Les bleus, blancs et rouges ont
des contrepoints. Les bandoulières parallèles de buffleterie
blanche répondent au blanc des guêtres et de la chemise du
cadavre de gauche. La tonalité grise exalte le rouge de
l’étendard.
Questions de la
page 157 : LES RÉGIMES POLITIQUES EN FRANCE DE 1851 JUSQU’À LA
VICTOIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
1• doc(s) 1, 3 :
Identifiez les différents
pouvoirs. Qui vote ? [6 points]
Pourquoi peut-on dire que
la IIIe République est une démocratie parlementaire ?
Il y a le pouvoir
exécutif composé d’un Président de la République et d’un gouvernement.
[2 points]
Le pouvoir législatif
est incarné par le Parlement, composé de la Chambre des députés
et du Sénat,
initiant et votant la loi. [2 points]
Les citoyens (évoqués dans le document 1) votent : il s’agit
d’un suffrage
universel masculin pour tous les hommes âgés de plus de
21 ans.
Il s’agit d’une démocratie parlementaire car le Parlement détient une
place importante dans le fonctionnement de la
République :
- il élit le Président de la République
- le gouvernement est responsable devant le Parlement.
2• doc(s) 2 :
Comment la gravure
présente-t-elle la reddition de Sedan ? [3 points]
L’empereur Napoléon III est assis dans son carrosse, encadré de cavaliers allemands.
Au 1er plan, un cavalier français et son cheval, morts,
alors que des soldats français ont leurs armes au sol mais
surtout tournent le
dos à l’empereur. Soldats dépités : un à gauche (pied sur le
canon) visage tenant sur son bras droit, un à droite de l’image,
visage dans les mains. La reddition est donc présentée comme un
désastre militaire sans précédent.
3• doc(s) 4 :
Par quel moyen les «
communards » tentent-ils de résister aux « Versaillais » ?
[2 points]
Les Communards ont construit des barricades dans tout Paris afin de résister
aux Versaillais et se sont
armés.
4• doc(s) 5 :
L'auteur de la caricature
oppose deux figures de la République : laquelle symbolise une
République modérée et pacifique ? [6 points]
Laquelle symbolise une
République violente et armée ?
À quel événement récent
cette caricature fait-elle allusion ?
À gauche est figurée une République modérée, habillée de manière rustre,
tenant un balai usé
dans ses mains. Sur son jupon est indiqué « République
honnête ». [2 points]
À droite est figurée une République plus engagée ; sur sa robe rouge est indiquée
« République rouge ». Elle a l’air menaçante,
tient des faisceaux
ensanglantés dans ses mains, a un pistolet à la ceinture,
rappelant qu’elle est prête à combattre et à se défendre contre
les ennemis de la République. [2 points]
Cette opposition rappelle l’opposition du début de l’année 1871 avec l’épisode
de la Commune
où le gouvernement provisoire, réfugié à Versailles, a écrasé
les révoltés parisiens (qui revendiquaient une République
sociale). [2 points]
Exercice 2
pages 160 : Je donne du sens à des repères
chronologiques à partir d'un texte
1•
Quelle est la nature du texte ci-dessous ? De quand date-t-il
? Quel est son auteur ? [3 points]
Le texte est un discours
prononcé par Georges
Clemenceau le 6 mars 1883 à la Chambre des Députés.
2• Quels événements de
l’histoire de France ce texte rappelle-t-il ? Figurez sur une
frise chronologique les différents événements évoqués par le
texte. Quelle est leur signification ? [5 points]
Georges Clémenceau rappelle différents événements importants du
XIXe siècle :
— la Révolution
française entre 1789 et 1799 qui fait disparaître l’Ancien Régime,
supprime la monarchie en 1792, permet l’émergence et l’exercice
de droits et libertés, instaure le régime d’égalité entre les
citoyens.
— les Trois
Glorieuses de 1830 qui permettent de chasser Charles X.
— la Révolution de
1848 qui chasse Louis-Philippe du pouvoir
— la proclamation de la
IIIe République en septembre 1870.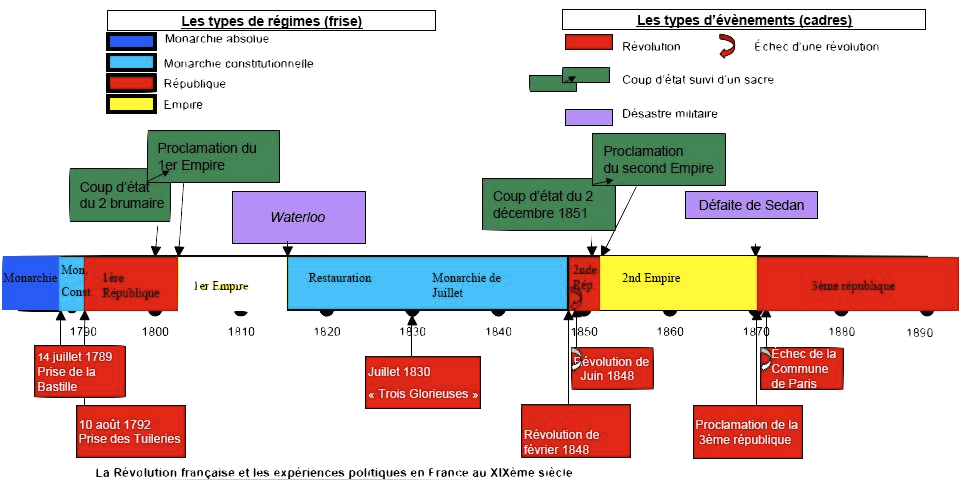
Frise
de Bernard Gassin http://hg-gassin.chez-alice.fr/1789-1851/correction-frise-1789-1880.jpg
3•
Pourquoi en France la République est-elle indissociable de la
Révolution ? [7 points]
Dans le fonctionnement de la IIIème République (la plus
aboutie), c'est le suffrage universel qui est à l'origine du
pouvoir exécutif et des lois, le suffrage universel est mis en place par les
républiques et retiré (ou réduit) par les monarchies.
La Révolution ou les insurrections
mettent en place les républiques (exception pour la
monarchie de juillet), le droit de « résister à l'oppression »
est reconnu dans la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen.
L'illustration du Grelot sur les deux républiques montre
que même la
république modérée reprend les couleurs de la Révolution
française.
D'après le texte de Clemenceau, la République est indissociable
de la Révolution, car il s’agit du régime le plus approprié pour
permettre l’exercice
de libertés et de droits et les avancées nécessaires
pour les citoyens. Clemenceau souligne que la mise en place de
monarchies (Restauration, Monarchie de juillet, 2d Empire) a
toujours conduit à un recul des acquis révolutionnaires.
En France la
République est liée à la démocratie et a l'opposition à la monarchie,
par contre dans certains pays d'Europe, ce sont des monarchies
qui ont mis en place la démocratie (et pour eux, république et
révolution sont synonymes de troubles).